Tuesday, November 11, 2025 • 5 min de lecture
La standardisation, vice ou vertu ?

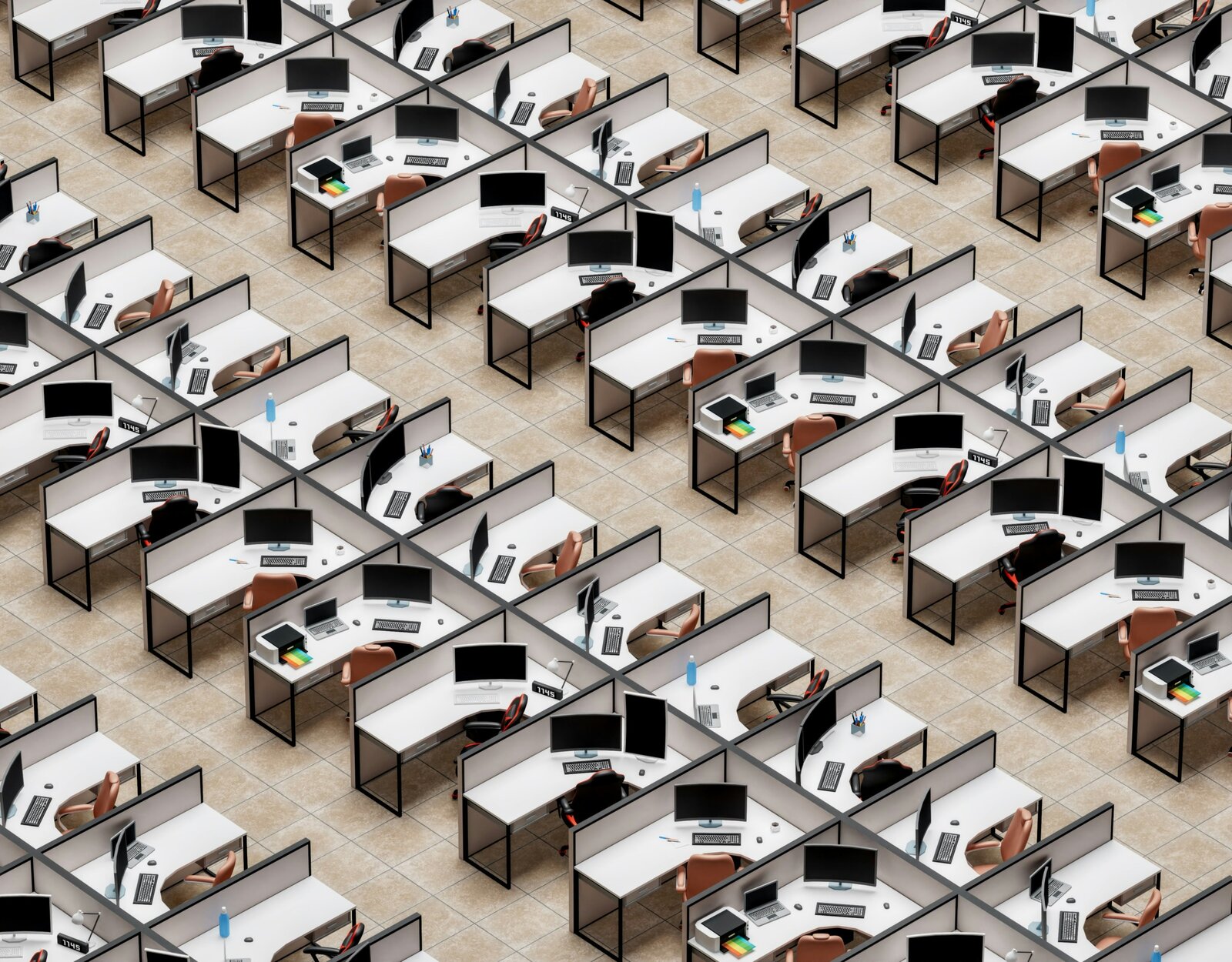
Pourquoi certaines organisations sont obsédées par les standards
Plus une organisation grossit, plus elle tente de rationaliser ses outils. Car avec la multiplication des outils, une complexité s'installe, les compétences se diluent, les erreurs se multiplient. Standardiser permet alors de retrouver un peu de contrôle et de simplifier les façons de faire.
La face sombre de la standardisation
Le problème de la standardisation, c'est qu'elle ne résoud pas toujours les vrais problèmes. Pour 3 raisons.
1. un standard est définit par un département (service informatique, sécurité, ressources humaines, ...), ou par un métier (une ligne de produits ou services, une spécialité, une expertise, ...) selon son point de vue. Chaque silo optimise pour lui-même sans mesurer les impacts de ses actions sur les autres équipes. Cela entretient une logique locale. Tellement locale qu'elle devient déconnectée du terrain et incapable de percevoir les impacts réels sur les clients ou bénéficiaires.
2. les équipes perdent leur autonomie : on suit une règle plutot que sa propre réflexion et son jugement. Et on perd en capacité à s'adapter aux nouveaux besoins ou aux évolutions des besoins existants.
3. l'introduction de nouveaux outils étant "interdite" par les standards, la capacité d'expérimentation disparaît et l'apprentissage diminue. On continue de faire comme on a toujours fait. Les solutions deviennent peu à peu inadaptées ou obsolètes. Elles finissent par manquer leur cible ou s'éteindre faute d'utilisateurs.
La standardisation n'a pas que des aspects négatifs. Mais poussée au dogme, elle les maximise. Sans aller jusqu'au dogme, la standardistion appliquée aux mauvaises priorités aboutit aux mêmes travers. Lorsqu'elle est mieux ciblée, elle devient un puissant outil d'amélioration continue.
La standardisation comme levier de performance
La standardisation est une contre-mesure à la variation. Or, la variation est un des principaux freins à la performance.
- Il y a la variation des besoins des clients : c'est comme la météo, on doit faire avec et s'y adapter autant que possible.
- Il y a la variation des resources de l'entreprise : absences, pannes, différences de pratiques, différences d'outils, différences de processus ou absence de processus. C'est principalement sur cette variation que l'organisation peut agir.
Dans deux précédents articles, je décrivais deux mesures distinctes de la performance:
- l'efficience des ressources, qui cherche à réduire les coûts : Quand trop d'efficience tue l'efficience
- l'efficience du flux, qui maximise la création de valeur pour le client : Comment vaincre le paradoxe de l'efficience ?
La matrice de l'efficience décrit le positionnement d'une organisation par rapport à ces deux critères.

Selon sa stratégie, une entreprise se positionnera dans cette matrice. L'entreprise A priorise l'efficience des ressources. Sa stratégie est probablement basée sur une compétitivité par les coûts. L'entreprise B priorise l'efficience des flux et l'expérience client. Sa stratégie est plutôt basée sur une forte différenciation. Dans un cas comme dans l'autre, ces entreprise peuvent adopter une démarche d'amélioration continue pour améliorer leur performance. Ce faisant, elles se déplacent dans la matrice. À terme, elle pourraient alors atteindre le point représentant 100% sur les deux axes, l'état idéal. Mais cet état est un idéal théorique, impossible à atteindre.
La frontière de l'efficience.
La frontière de l'efficience délimite les états accessibles à une organisation dans la matrice. Seuls les points à gauche ou en dessous de cette frontière sont accessibles. Ce qui empêche une organisation de dépasser cette frontière et d'atteindre cet idéal, c'est la variation. Plus la variation est importante, plus il est difficile pour une organisation de s'approcher de l'état idéal.
La variation agit selon différents axes. En voici un exemple. La demande des clients est rarement stable et prévisible. Une baisse de la demande se traduit généralement en une surcapacité des ressources. Cette surcapacité réduit l'efficience des ressources qui n'est plus de 100 %. À l'inverse, un surcroit de demande sature les capacités et crée de l'attente pour le client. Le flux ralentit et son efficience n'est plus de 100 % du fait de ces temps d'attente.
La variation des ressources de l'entreprise génère les mêmes effets négatifs. Par exemple, une panne ou un défaut de conception entrainent du surtravail pour les équipes, et de l'attente pour le client.
Gérer la variation
Réduire la variation est donc un facteur d'amélioration pour l'entreprise car elle augmente les positions possibles en direction d'un état idéal. Si la variation des ressources peut être réduite par une organisation, celle des besoins du clients n'est pas sous son contrôle. Elle doit donc apprendre à gérer cette variation et s'y adapter.
Cela nécessite de déveloper deux types de compétences.
- L'anticipation des variations des besoins,
- et la flexibilité de son organisation.
C'est dans ce cadre que doit s'appliquer la standardisation : permettre d'anticiper, par exemple en standardisant les processus et les indicateurs, et permettre de s'adapter en facilitant les changements. Par exemple, cela peut être réalisé grâce à une plus grande modularisation et l'utilisation d'interfaces standards.
Conclusion
La standardisation ne doit pas être envisagée comme une réponse universelle, mais comme une contre-mesure contextuelle.
Mal orientée, elle alimente les silos, réduit l'autonomie et étouffe l'apprentissage. Appliquée avec discernement, elle permet au contraire de réduire la variation inutile, d'améliorer la prévisibilité et de soutenir l'amélioration continue.
Le défi n'est donc pas de choisir entre liberté et standards, mais de trouver le juste niveau de standardisation : celui qui maximise la valeur créée pour le client tout en préservant la capacité de l'organisation à apprendre, expérimenter et s'adapter.
C'est cet équilibre dynamique qui permet de s'approcher, pas à pas, de la frontière de l'efficience.
Pour aller plus loin
Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande fortement la lecture de ce livre :
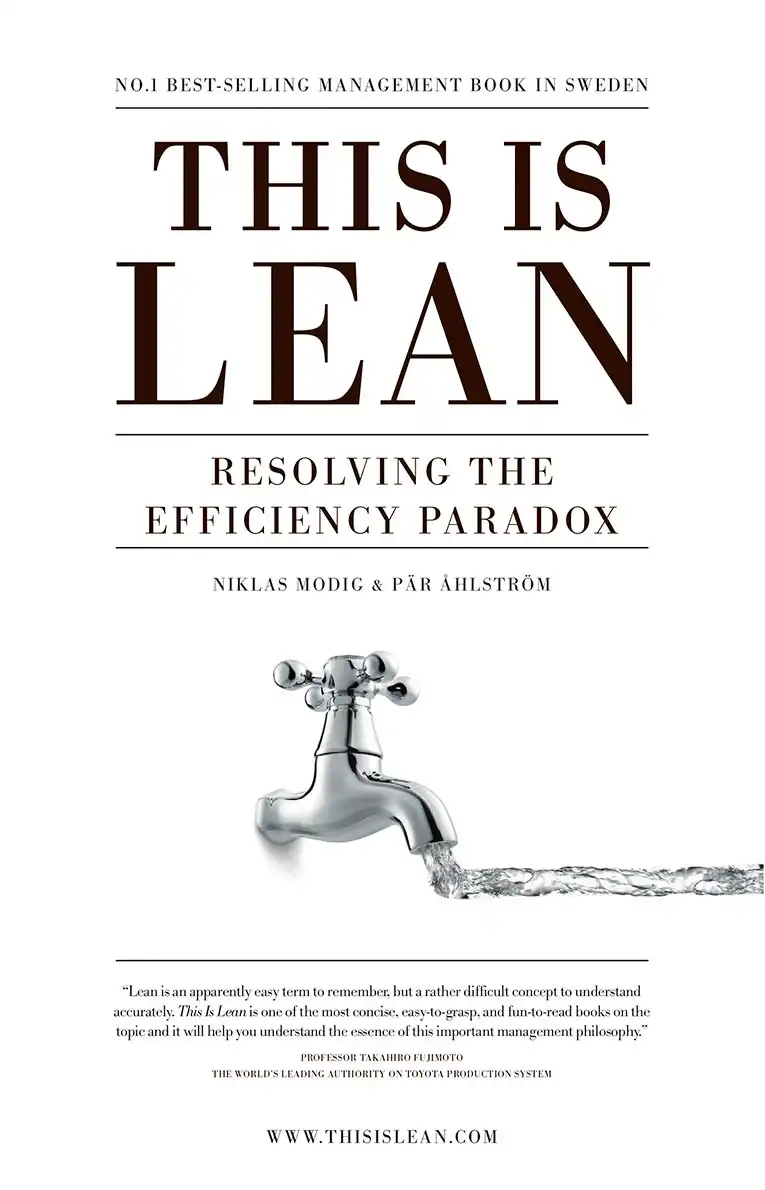
Le Lean en Clair
Par Niklas Modig et Pär Åhlström
Ce livre explique brillamment la différence entre l'efficacité des ressources et l'efficacité des flux. À travers des exemples clairs et une narration engageante, il démontre pourquoi se concentrer sur l'efficacité des flux conduit à de meilleurs résultats pour les clients et les organisations.
L'idée clé : les organisations optimisent souvent pour garder les ressources occupées (efficacité des ressources) alors qu'elles devraient optimiser pour un flux de valeur fluide (efficacité des flux). Ce changement fondamental de pensée est au cœur du Lean.
Je l'ai déjà recommandé et offert à un nombre incalculable d'amis et de relations.
En savoir plus sur le livre →Si vous n'aimez pas lire, appelez-moi. J'adore en discuter.